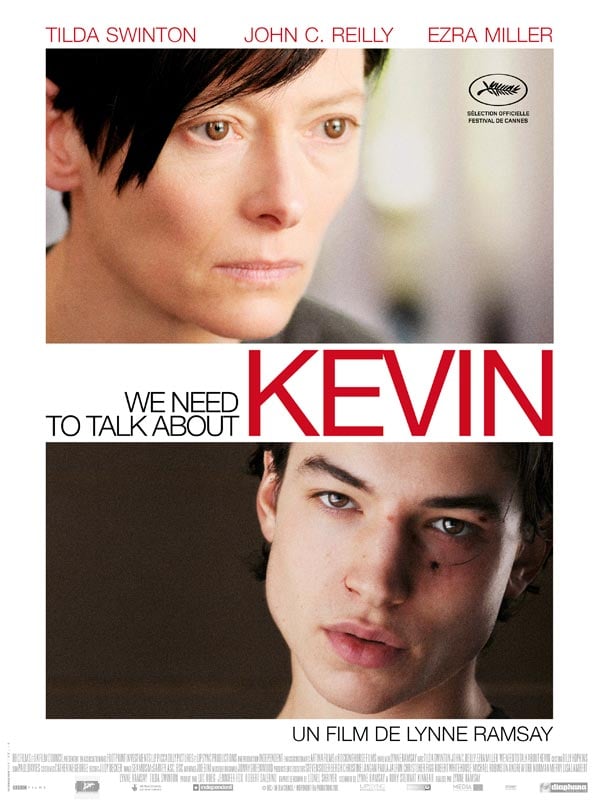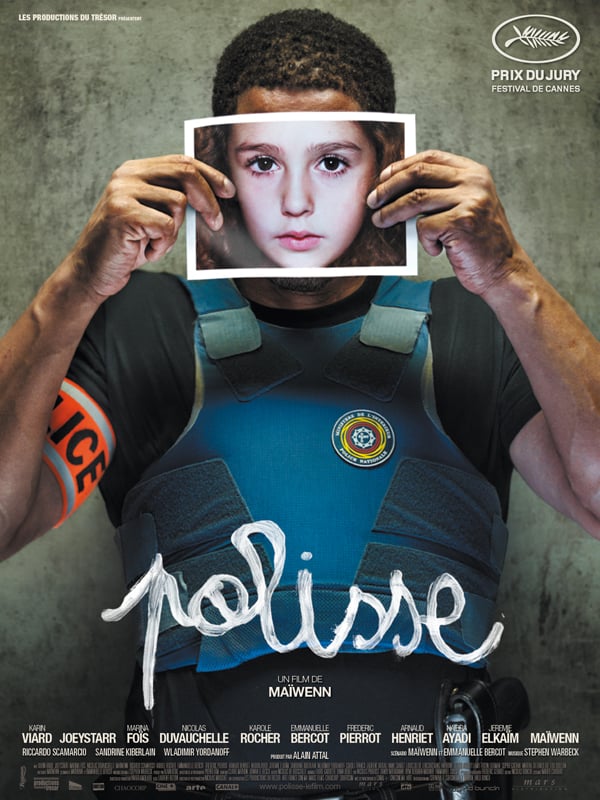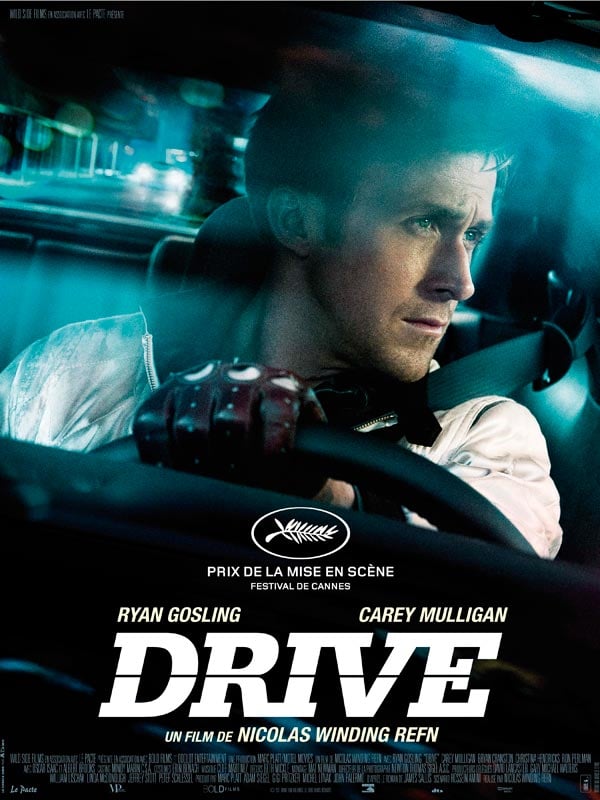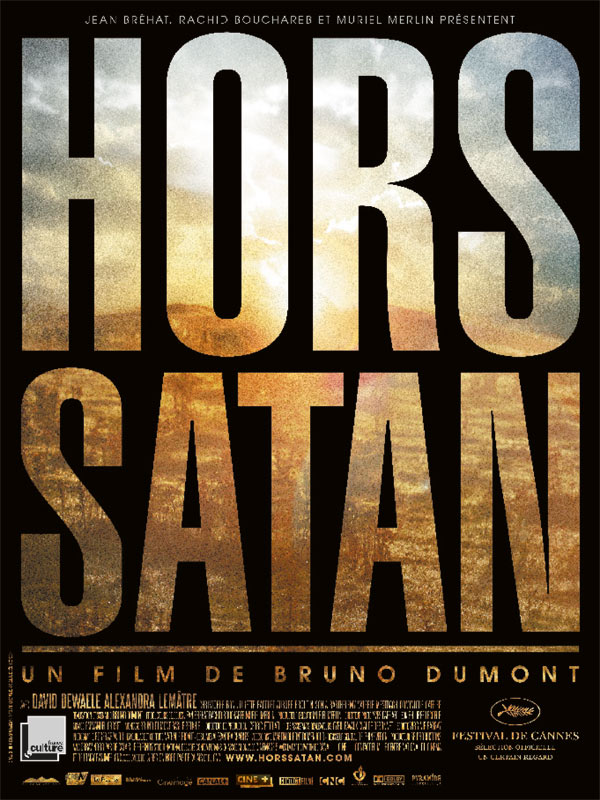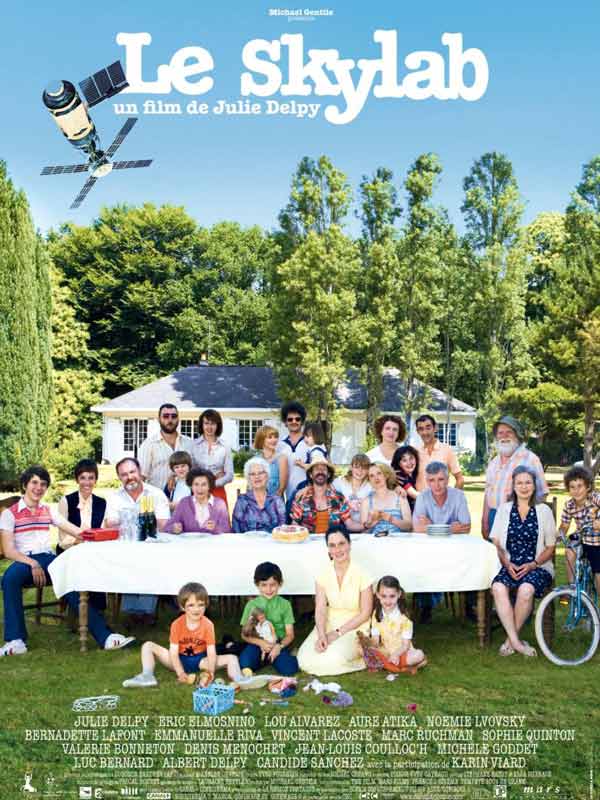Feist - Metals
Feist offre une suite à son fabuleux album "The Reminder" (souvenez-vous : 1234, My Moon My Man, I Feel It All, Honey honey... et autres tubes riches et intelligents alternant avec des balades douces et travaillées). Lorsque j'avais vu Feist en concert pour sa tournée précédente, j'avais été marqué par son manque d'intérêt pour le spectaculaire : Feist est une artiste, elle n'en a clairement rien à carrer de faire "1234" avec des gros beats pour plaire aux fans occasionnels, elle préfère sans hésiter le travail musical pour offrir sur scène des réinterprétations ingénieuses et magnifiques.
C'est un peu dans la continuation de cette façon de penser que "Metals" se place. A la première écoute, il s'avère résolument homogène et un peu 'froid' : les mélodies sont jolies et semblent se répondre, se mélanger dans un disque cohérent et intimiste. C'est au fil des écoutes que les chansons s'individualisent : on apprend à aimer le thème cruel au rythme entêtant de l'introductive "The Bad In Each Other", à reprendre les chœurs du brillant "Graveyard" (futur single?), à danser aux cris tribaux de "A Commotion" et à vivre un moment de relaxation rarement égalée sur "Cicadas & Gulls". La fin de l'album, quant à elle, enchaîne le puissant "Comfort Me" et le merveilleux et tendre "Get It Wrong, Get It Right".
C'est alors que l'on peut vraiment réaliser le travail incroyable entrepris par Feist sur cet album : chaque chanson est profondément ciselée avec art. Les rythmes sont incroyables, le choix des instruments est discrètement génial, la voix est toujours aussi caractéristique et à l'aise. Les textes, de leur côté, comportent toujours cet élégant côté onirique, vague et beau. En réalité, c'est un album qui revisite la sobriété de "Let It Die" avec la richesse musicale de "The Reminder", et en devient un opus nouveau, grand, qui parvient à créer une atmosphère indéfinissable et profondément émouvante. Pour conclure, je paraphraserai Laurent Hoebrechts du site Focus Vif : "Le 4e album de Feist porte bien son nom : d'apparence froide, Metals laisse formidablement passer la chaleur."
Björk - Biophilia
Enfin ! Le dernier Björk, "Volta", date de 2007. Et, bon, entre nous, disons, pour être sympa, qu'il ne compte pas. Ainsi, pour le dernier vrai Björk, comprenez le dernier où elle imposait une fois de plus son génie avec un concept original, réussi et des chansons inégalables, il faut remonter à "Medulla" en 2004. Autant vous dire qu'on l'a attendu, le "Biophilia". Cet album, qui plus est, n'en est pas vraiment un : créé à partir d'instruments inédits façonnés pour l'occasion et en partie sur iPad, il a été conçu pour être écouté sur iPhone, où chaque chanson est sortie sous forme d'application où l'on avait l'occasion de retravailler nous-mêmes la musique de Björk. "Biophilia" est défini comme une œuvre aux confins de la musique, de la technologie et de la nature.
C'en est effectivement le thème récurrent : par des textes inventifs, Björk parvient à faire ce qu'elle fait le mieux en signant dix chansons qui traitent, selon le point de vue, de phénomènes naturels (de l'atome au cosmos) ou de relations humaines. Le gai "Virus" en est un bon exemple : la cellule appelle le virus à l'infecter, la femme appelle l'homme à l'aimer ; "Sacrifice" est une lettre ouverte de l'artiste aux hommes qu'elle appelle à respecter la planète comme une épouse qu'il ne faut plus maltraiter. Le jeu du double sens n'a jamais été tant exploité par Björk et lui permet de délivrer ses messages écologiques tout en permettant à l'auditeur d'y trouver autre chose, en exploitant cette fusion de l'homme et de la nature comme une relation amoureuse passionnelle.
"Biophilia" est donc un voyage à travers la nature : l'ambiance est posée, sombre, hypnotique. On pourra regretter, malgré la variété des instruments, une relative homogénéité froide de l'ensemble, même si c'est ce qui apporte la cohérence d'un album puissant qui peine néanmoins à être personnel. Ainsi, certains morceaux apparaissent résolument sombres, voire opaques ("Dark Matter", "Hollow") et, malgré une finesse du travail, restent quelque peu inaccessibles, en raison d'une ligne musicale pas toujours clairement définie. Mais quand les mélodies percent, elles sont à la fois grandement björkiennes ("Solstice" rappelle l'époque "Vespertine") et innovantes, rassemblant tout ce qu'elle a pu amasser dans ses albums précédents : "Mutual Core" ressemble à une version plus réussie et enfin maîtrisée de "Triumph of a Heart" ou "Earth Intruders", présentant un rythme chaotique mais suffisamment contrôlé - à l'inverse de la fin ratée de "Crystalline" qui en détruit l'ambiance pourtant spéciale. En résumé, ce que Björk avait ébauché (bâclé?) dans "Volta" trouve sa forme ici et devient magistral : "Thunderbolt" et son refrain inquiétant en sont le parfait exemple, un morceau puissant, à la fois anxiogène et salvateur, porté par une voix toujours plus maîtrisée et plus pure.
En cela, on peut dire que "Biophilia" est l'aboutissement du travail de Björk : elle innove, elle reprend ce qu'elle a appris, elle s'exprime enfin complètement sur le sujet qui l'a toujours fait vibrer davantage, tout en laissant au public le loisir de ne pas s'y enfermer, et c'est ainsi que, malgré quelques ratés, l'album est une réussite qui restitue Björk comme Déesse de la Musique. Rien que ça.
Camille - Ilo Veyou
Qu'est-ce qu'elle pouvait encore bien nous inventer, Camille ? L'artiste est sans doute à la fois une des plus talentueuses et des plus sous-estimées en France, parce que les quelques chansons radiophoniques que les gens connaissent ne représentent qu'une infime partie de son génie. Elle nous a prouvé sa fraîcheur avec "Le sac des filles", son originalité créative avec "Le fil", son oreille musicale parfaite avec "Music Hole". Le portrait était dressé ; et elle le porte plus loin encore avec "Ilo Veyou", en nous entraînant dans une remarquable traversée du monde de la musique.
En vertu de l'organe incroyable de la chanteuse, la part belle est de prime abord accordée à la voix, donnant naissance à des morceaux presque acapella intimistes où l'émotion fleurit avec facilité et force : "Pleasure" ou "Le banquet" en sont de bons exemples, ou encore le touchant single "L'étourderie". "Tout dit", qui clôt l'album, allie texte poétique, spontanéité hypnotisante et maîtrise surhumaine du rythme. Mais pour émouvoir, Camille a plus d'une corde à son arc, et utilise aussi des morceaux savamment orchestrés, tels que "Le Berger", "She Was" ou "Wet Boy" qui sonne comme la suite de "Winter's Child".
Cependant, elle nous entraîne aussi vite vers d'autres contrées : une visite rapide du jazz avec le frais "Bubble Lady", la chorale d'enfants avec "Allez allez allez" (un peu moins agréable, Camille n'étant pas toujours facile à suivre dans ses délires personnels), et des perles colorées et sucrées telles que "Message". Bien sûr, on passe par des morceaux typiques de Camille comme "Ilo Veyou", "Mars Is No Fun" ou "My Man Is Married But Not To Me", où elle allie son sens du rythme à une voix lancinante et des mélodies sur mesure, pour des morceaux caractéristiques mais originaux. Cette grande traversée musicale passe aussi par une délicieuse caricature de la grande diva, qui n'est plus l'actuelle Mariah Carey comme c'était le cas dans l'album précédent avec "Money Note", mais cette fois la nationaliste de la Belle-Epoque, avec l'hilarant et sarcastique "La France".
C'est donc enthousiasmé que l'on ressort de ce tour musical à l'agréable diversité rappelant en cela "Le Sac des Filles" : Camille s'amuse, nous amuse, s'émeut et nous émeut ("Aujourd'hui"), dans des chansons parfois personnelles mais jamais mises en scène. Camille expérimente les multiples possibilités qui s'offrent à elle et nous ravit du résultat qui arbore à la fois une maîtrise et une fraîcheur dans un duo rarement égalé.
Et dans la rubrique "Après la bataille"...
Florence + The Machine - Lungs
A chaque fois, la voix jaillit, le texte est corrosif et poétique, la musique enrobe le tout avec soin et modernité. Si d'autres morceaux marquent un peu moins, ils comportent tous un trait caractéristique qui les rend intéressants : c'est le cas de "I'm Not Calling You A Liar", "Girl With One Eye"...
Florence + The Machine a la spécificité de porter parfaitement la musique de son temps, avec une richesse musicale et une clarté vocale à toute épreuve, mais tout en créant une personnalité qui s'exprime dans la musique avec élégance et décalage. La voix est puissante et profonde, elle éclate en s'amusant et en souffrant. L'instrumentation est dense mais jamais trop chargée, pour un résultat optimal. Avec une maîtrise étonnante des temps morts et des explosions de son, Florence + The Machine est une découverte qui est venue rythmer mes journées. Elle sort un nouvel album aujourd'hui (comme quoi je ne suis pas vraiment du tout à la bourre), vous en aurez
Dans la rubrique "Vite, avant que vous ne vous rendiez compte que je n'écoute que des chanteuses à voix, à texte et bizarroïdes..."
Alex Beaupain - Les Bien-Aimés
J'en ai déjà parlé beaucoup avec le film dont il s'agit de la bande originale. En résumé, les voix ne sont pas des voix de chanteurs, mais la production parvient à le faire fonctionner à l'avantage des chansons, en utilisant justement ce côté fluet et fragile : les morceaux de Chiara Mastroianni en sont un excellent exemple, avec les très jolis "Jeunesse se passe" ou "J'en passerai". Du côté de Catherine Deneuve ou Ludivine Sagnier dont les manières vocales s'allient au contraire mal avec le reste, c'est plus laborieux. En fait, ce sont les textes qui sauvent l'album : des chansons comme les excellentes "Qui aimes-tu ?", "Ici Londres" ou "Puisque tu m'aimes" sont écrites d'une plume sublime. Mais là où le bât blesse, c'est assurément du côté de la musique : elle rappelle la grande époque de Claude François, les cordes semblent pré-enregistrées comme dans un mauvais remix et on déplore la pauvreté de l'instrumentation. Ainsi, si cet album restera bon pour quelques morceaux triés sur le volet et sauvés par l'écriture, son écoute intégrale tient vite de l'exploit fatigant... Alex Beaupain devrait vraiment rester parolier...