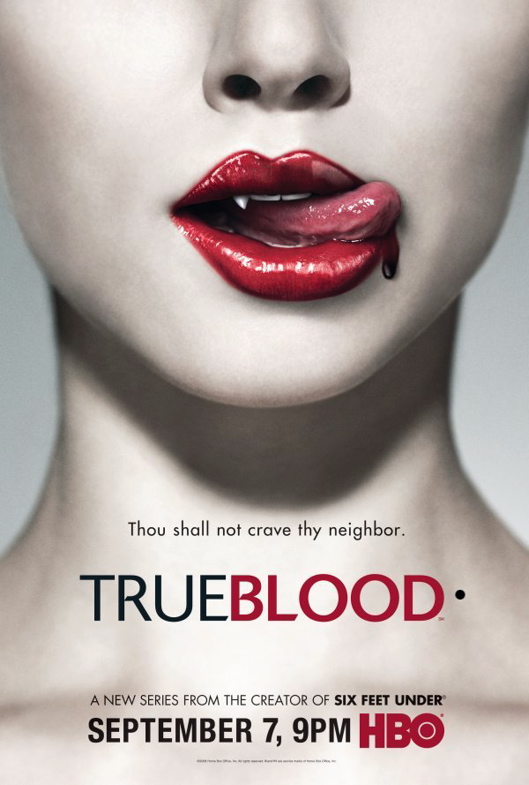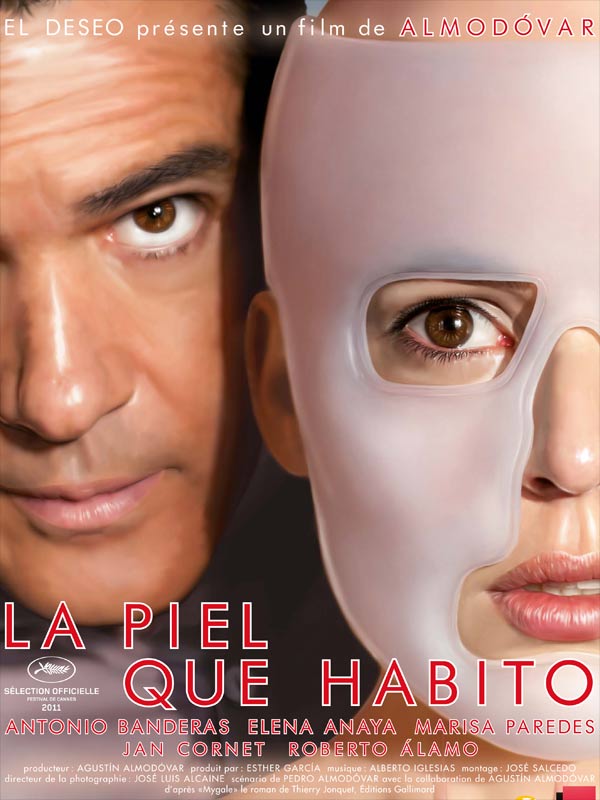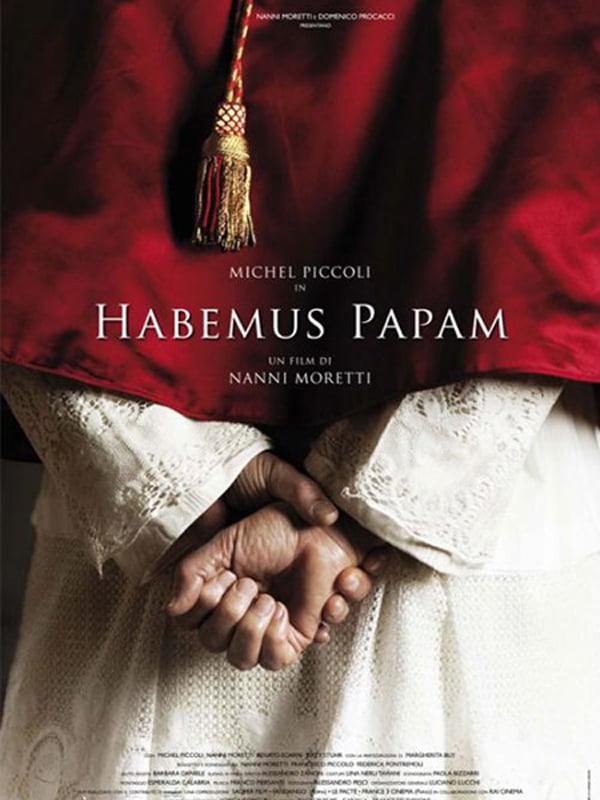Il est de ces films que l'on manque sans regret, que l'on ne cherche pas vraiment à voir après leur sortie et que l'on se résout à regarder seulement quand il n'y a rien de mieux à faire. C'est une attitude souvent avisée; mais on peut aussi passer à côté de vraies pépites déguisées. C'est le cas de ce film, "Bliss" en France, "Whip It" chez Drew Barrymore. En effet, que les choses soient claires : niveau scénario, c'est un peu la lose, comme on dit. La lecture du synopsis mène inévitablement à passer son chemin ; il s'agit quand même d'une lycéenne que sa mère force plus ou moins à faire des concours de beauté pour revivre sa propre gloire d'antan, mais qui découvre des compétitions de roller et préfère largement ça, alors elle le fait en cachette en mentant sur son âge et en tombant amoureuse, jusqu'au jour où tout le monde découvre le pot-aux-roses. Bon. Je vous avais prévenus. Et pourtant, rassurez-vous, je n'ai pas perdu mon bon goût légendaire quand je vous dis que ce film est génial.
Déjà, le scénario est corrigé par le fait qu'il ne tombe pas dans tous les pièges du genre, avec notamment quelques surprises sur la fin qui relèvent le niveau du récit. Mais surtout, il est absolument transcendé par une narration incroyable de vivacité, d'originalité, d'insolence et de sincérité. Le film est constitué de scènes explorant des relations complexes et belles, saupoudré de dialogues ciselés de répliques piquantes à se tordre de rire et fourré d'une multitude de clins d’œil que l'on découvre et redécouvre au fil des visionnages. Est dressée une galerie de personnages pittoresques, mais qui ne tombent jamais (ou rarement) dans le cliché et bénéficient tous d'une évolution et d'une exploration crédibles et intéressantes. Est représentée une ambiance joueuse, sans compromis et résolument naturelle, qui s'oppose joyeusement à l'atmosphère guindée des concours de beauté, comme pour mieux représenter le gouffre au-dessus duquel Bliss se tient, un roller sur chaque rive.
Le tout est aidé d'une réalisation efficace et dynamique, relevée d'une photographie colorée. On ne tombe pas non plus dans les facilités de la réalisation indie, mais on en garde la fraîcheur. Drew Barrymore, aussi insupportable soit-elle dans les entretiens, nous y apprend qu'elle a travaillé sur ce film avec un soin maniaque, et cela se ressent, tant rien n'est laissé au hasard pour faire de ce long-métrage quelque chose d'étonnamment nouveau sur un terrain usé des milliers de fois. Elle délivre d'ailleurs une prestation légère et amusante, dans un rôle aux antipodes de la talentueuse Marcia Gay Harden, encore une fois aussi charismatique que juste. Le casting dans son intégralité a été sélectionné avec goût pour représenter au mieux tous ces personnages hauts en couleur, et à ce titre, Ellen Page faisait un choix évident. Peut-être un peu trop évident, après "Juno", les deux rôles étant quand même similaires, mais son naturel et sa sincérité nous font plutôt penser qu'on ne change pas une équipe qui gagne.
Ainsi, "Whip it"/"Bliss" est un film comme on en voit peu : dynamique, frais et novateur, il parvient à rouler sur les limites du cliché pour revisiter un genre comme jamais auparavant, le tout avec humour, soin et grâce.