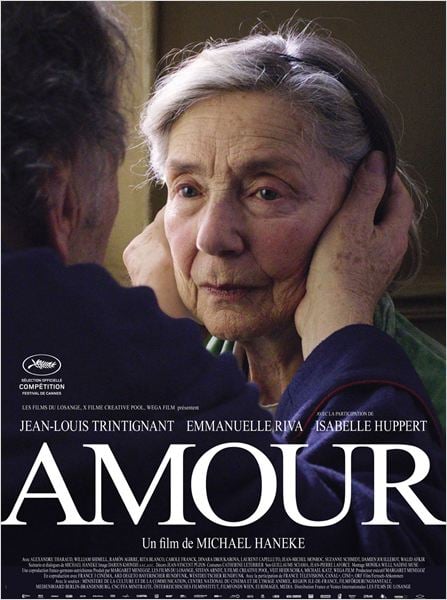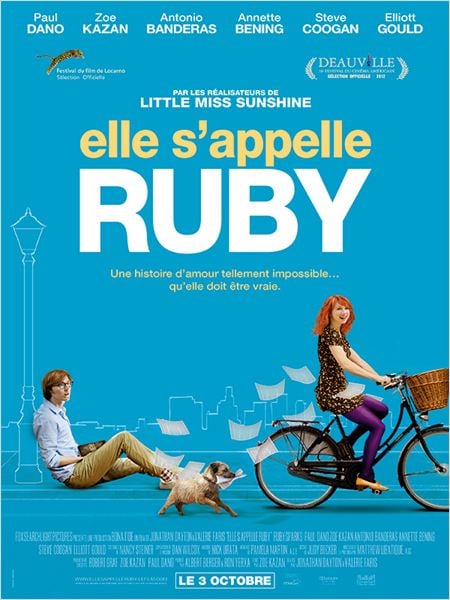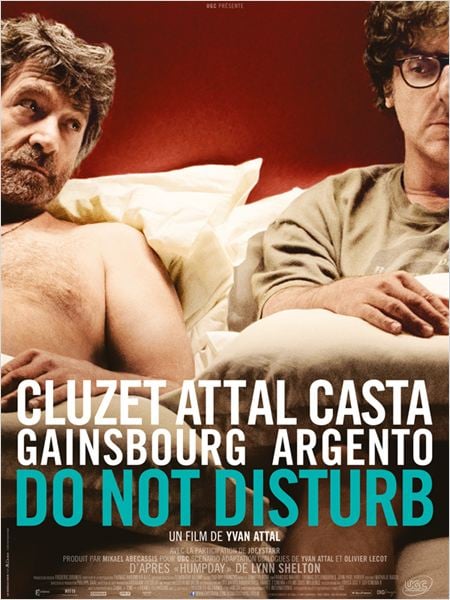Encore un de ces films sud-américains qui parfois nous parviennent outre-Atlantique ? Ici, c'est le Mexique. Lucía, et son accent sur le i super relou à retranscrire sur un clavier franco-français, n'apparaîtront jamais dans le film. Il s'agit de la mère et de l'épouse des deux protagonistes, qui tentent de refaire leur vie après son décès. Dans une nouvelle ville, le deuil de la jeune Alejandra la conduira vers des chemins de souffrance indicible.
Il y a une sorte de maîtrise insolente dans "Después de Lucía". Une réussite assumée et univoque, dans un scénario qui, aussi habilement que subrepticement, dévie vers des thèmes inattendus dont il fera son sujet. Dans une réalisation froide, clinique et pourtant d'une clarté limpide et irisée. Dans le choix des très bons Tessa Ia et Hernán Mendoza. Dans une direction d'acteurs quasiment outrageante, en se payant le luxe un brin crâneur d'une composition démentielle presque exclusivement sous la forme de plans-séquences, forçant le respect. Ainsi ne peut-on qu'être convaincu par un film où tout résonne d'une grandeur calme, d'un exploit serein, d'une terreur amusée. On le suit donc sans broncher. Le rythme est haletant, le souffle est coupé.
Mais jusqu'à quel point tout cela suffit-il ? Savoir passer les rênes sur son étalon, c'est très bien... mais ensuite, encore faut-il savoir où l'emmener. Et la gradation dans l'horreur que nous offre ici Franco semble, in fine, ne se résumer qu'à cela. La noirceur pour la noirceur, le désespoir pour le désespoir, le tout teinté du vide de l'autosatisfaction. Le nom de l’œuvre pointerait dans une direction qui n'est que trop peu explorée. Si la souffrance est mère de l'art, l'art ne peut pas n'être que souffrance. Aussi ce chef d’œuvre de forme et de thème pêchera-t-il par son absence de fond vrai, son manque de regard, son refus du point de vue. Et s'il glacera le spectateur, jusqu'à une fin aussi atroce que fascinante, au final, il le laissera un peu trop froid.