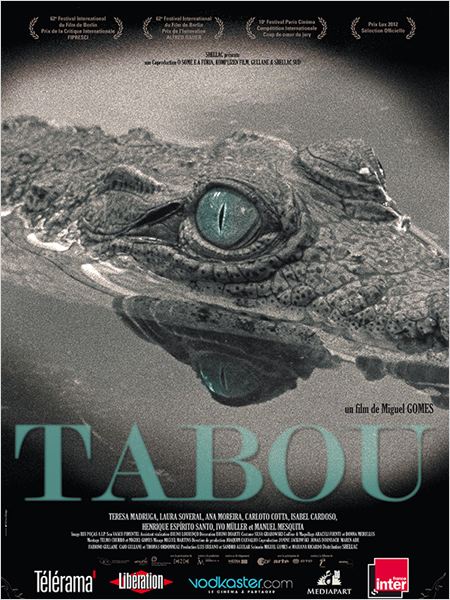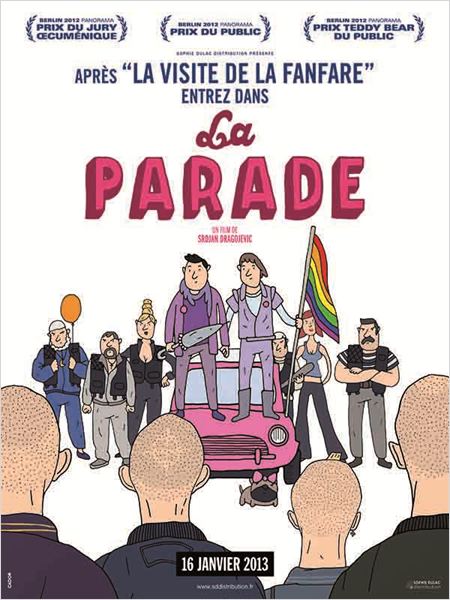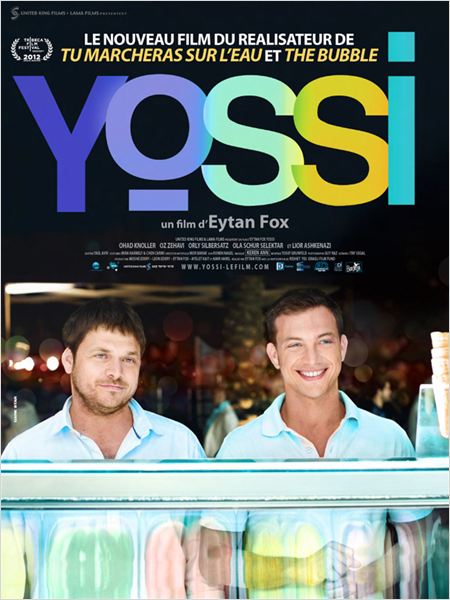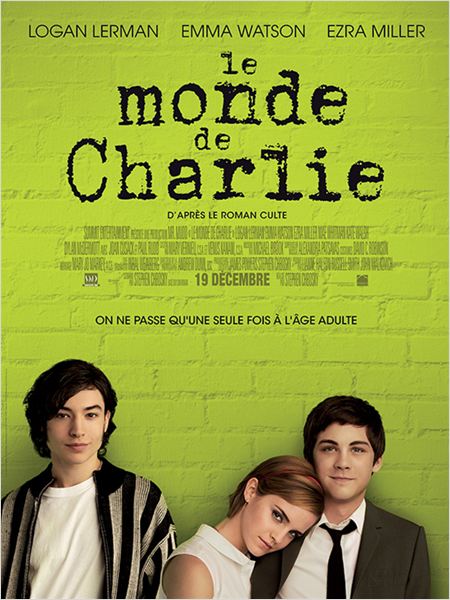Ouch. L'adaptation du chef d’œuvre de Tolstoï. Pire : la treizième adaptation du roman. Avec la fatigante Keira Knightley dans le rôle-titre. Un film distribué à l'UGC, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Mais n'ayez crainte : Joe Wright a déjà aussi adapté "Pride & Prejudice", de façon plutôt goûtue, et aussi l'excellent "Atonment", qui faisait preuve d'une réalisation intelligente, fière et astucieuse. Essayons, donc.
Ce qui frappe avant tout, c'est justement la réalisation : c'est elle qui portera le film tout entier, et le rendra finalement bon. Wright se surpasse, en mélangeant, virtuose amusé, les codes du théâtre, du cinéma dramatique et de la comédie musicale. S'en suivent de multiples scènes d'un esthétisme probant, à travers un éclairage brillant, des couleurs foisonnantes et une composition précise ; mais c'est surtout cette succession millimétrée et rythmée des décors, qui se font et se défont de façon à la fois poétique et spectaculaire. Anna Karenina, plus que jamais, se retrouve au milieu d'une scène de théâtre où le public de ses contemporains scrutent chacun de ses mouvements et s'apprêtent à la huer. La portée symbolique de l'ensemble du long-métrage en fait une œuvre d'art à part entière, qui finit de faire de Wright un réalisateur d'une créativité passionnante.
Cette formidable machinerie vole en fait la vedette aux acteurs. Si Knightley est certes meilleure que ce à quoi elle nous a habitués récemment, notamment moins schématique que dans "A Dangerous Method" et plus impliquée que dans "Last Night", c'est moins sa performance que sa beauté utilisée comme parure et sertie dans l'écrin que lui assortit son directeur, qui marquera. Les autres acteurs semblent instrumentés de la même manière ; on remarquera seulement la toujours excellente Olivia Williams. Tous ne sont que pions sur l'échiquier de l'artiste, qui veut ainsi retranscrire la passion aussi spéciale qu'universelle de cette célèbre histoire. Cela dit, toute cette majesté contre-indique l'intimité, et la narration finit par s'essouffler. Alors faisons fi de cette impossible prouesse de faire tenir ce millier de pages dans deux heures bien tenues, et que tout le monde continue de tenter. En reste surtout la grandiloquence : c'est déjà bien.
mercredi 30 janvier 2013
mardi 29 janvier 2013
"Tabou", Miguel Gomes
Un film portugais en noir et blanc distribué dans le plus petit cinéma d'arts et d'essai du centre-ville. Vous pensez bien que j'étais obligé d'y aller.
Je ne sais pas définir ce qui constitue toute la qualité de "Tabou", et qui lui a valu les éloges méritées des critiques. L'histoire est simple, son schéma narratif pourrait même paraître simpliste et bancal : deux parties, la fin de vie de la protagoniste âgée, puis l'épisode le plus important de sa vie, des décennies plus tôt. Là, l'amour, la désillusion, la passion, l'interdit, la tragédie, tous ces thèmes galvaudés des amours impossibles. La réalisation, dans ce noir et blanc assumé assorti au temps colonial représenté, est tout aussi résolument kitsch que l'époque en question. Elle donne une teinte surannée à la pellicule, qui fréquemment semble elle aussi d'un autre temps, et le décor exotique crée une ambiance tantôt étouffante, tantôt paradisiaque. Il y a une triste évidence, nonchalante et mélancolique, dans la narration des événements : ils semblent regardés par un œil impuissant et une caméra aussi silencieuse que forte.
Pourtant, en regardant "Tabou", on se retrouve happé. C'est ici une façon innovante de faire du cinéma : de manière inexplicable, le film est exceptionnel. Peut-être est-ce dans le traitement sensible et déchirant de ses personnages, principaux comme secondaires, dont le portrait se construit, grand et évident, par touches subtiles et intelligentes. Alors sans doute est-ce aidé par une direction d'acteurs tout en retenue et une interprétation conséquemment fascinante, de la touchante Isabel Cardoso à la douce Teresa Madruga, du brûlant Carloto Corro à l'impassible Ana Moreira. Ou peut-être est-ce aussi dans la chaude délicatesse dialogues concis, poétiques et directs, qui semblent chuchoter entre leurs lignes. Peut-être est-ce dans ce point de vue clair et ému que le film porte sur la passion, avec une efficacité fiévreuse. Ou peut-être encore n'a-t-on pas besoin de comprendre de quelle façon Gomes s'y est pris pour rendre étrangement passionnante cette histoire-là, à cette période-là, avec ces personnages-là, dans cette couleur-là. Peut-être qu'on peut juste, pour une fois, accepter que l'artiste a compris quelque chose, sans s'interroger davantage, et simplement le laisser nous emporter.
jeudi 24 janvier 2013
"La Parade", Srdjan Dragojevic
Il y aurait fort à parier que la date de sortie du film ne soit pas tombée par hasard. Et pour cause : ce film traite d'homophobie... S'il s'agit de la dramatique situation en Serbie, la résonance avec les actualités parfois aussi peu glorieuses en France se fait claire.
Pendant les premières scènes, les personnages sont présentés, puis des liens improbables rapidement les unissent. Ce sont ces relations absurdes qui vont finir par créer l'histoire, touchante, drôle et originale, quand Lemon, un criminel de renom, pour sauver son histoire d'amour avec l'ingénue Pearl, se voit contraint de protéger la première Gay Pride de Belgrade, organisée par Mirko et son petit-ami Radmilo, qui très rapidement doit accompagner Lemon tout autour de la Serbie pour rameuter les autres peuples contre lesquels le malfrat s'est battu, afin de défendre cette cause qu'il a lui-même beaucoup de mal à soutenir... L'intelligence des rapports et l'aisance avec laquelle un scénario futé se construit ornent ce scénario d'une fraîcheur et d'une singularité rares. Au-travers de cela est parsemé un humour toujours potache, souvent attendu, parfois fin, globalement efficace.
Et puis soudain ce joyeux bordel, ce méli-mélo narratif bien maîtrisé, cette succession de gags et d'échanges inattendus stoppe net. De comédie, le film devient engagé. En fait pas du tout feel-good movie, "La Parade" surprend par un réalisme assumé et cruel. Le message de tolérance scandé avec force rires et coups de coude depuis le début du film, celui qui soulignait avec ironie et légèreté que l'on est tous la minorité de quelqu'un, se trouve soudain gravé dans la chair. Un éclat de rire brutalement interrompu. Le dénouement qu'on voyait se profiler ne pointe pas alors que l'histoire fait enfin dans la subtilité pour une conclusion en demi-teinte. Le film se renfrogne, son propos est évident et sans appel, et ses personnages hauts en couleur n'ont plus de poids face à lui. Il montre tout de même que l'espoir existe, mais qu'en attendant, tout le temps, partout, la lutte continue. A bon entendeur.
mardi 22 janvier 2013
"Yossi", Eytan Fox
Yossi est un vieux pédé. (Et bim, avec cette phrase, "Assurément" conservera, si besoin en est, sa top place dans Google avec le mot-clé bien connu.)
Vieux parce qu'il a plus de trente ans et que dans la cruauté du monde gay hyper-narcissique, si tu es trentenaire et que tu ne passes pas le plus clair de ton temps à forger ton corps selon les critères très précis du canon de beauté homo, tu es vieux et dégueu. C'est sans doute là la première réussite du film d'Eytan Fox : montrer la difficulté pour un homo pas forcément magnifique d'avoir une vie sexuelle et affective. Et ce même en Israël, car c'est à Tel-Aviv que Yossi exerce en tant que cardiologue bourreau de travail et esseulé. A un rythme lent et contemplatif, des scènes sombres et sèches suivent sa vie d'homme qui ne sait plus s'assumer, qui rate les occasions qu'il prend et qui ne sait pas prendre les occasions dont il pourrait tirer profit. Pendant longtemps, le film se contente de dépeindre avec goût cette vie pleine d'hésitations et d'errances, cette vie à côté de laquelle Yossi passe.
Et puis, au fil de ce voyage flânant, une rencontre, inespérée et impossible. Yossi, le très bien choisi Ohad Knoller, admire Tom (Oz Zehavi) un jeune et beau militaire homo, dont le train de vie n'a rien à voir avec le sien. L'histoire qui en naît tant bien que mal est sûrement un peu poussive, un peu facile même, mais la sensibilité avec laquelle elle finit par s'établir est un touchant et délicat message d'espoir. Notamment dans une scène où les deux hommes se mettent à nu, finalisant le portrait d'un homme qui a fini par se détester à cause de tous ceux qui l'ont rejeté, des deux côtés, lui interdisant l'accès aux communautés hétéro comme homosexuelle. C'est pourquoi on aura donc apprécié ce film sans prétention, baigné par l'excellente musique de Keren Ann, et qui réussit la tâche difficile de conduire avec intérêt un récit simple, mais qui sait finalement prouver qu'il a son importance, à sa manière. A l'image exacte de son protagoniste.
dimanche 20 janvier 2013
"Le Monde de Charlie" ("The Perks Of Being A Wallflower"), Stephen Chbosky
Je l'ai souvent dit, il y a des films dont on attend peu. Probablement à cause de critères bobos, par exemple qu'ils ne sont diffusés qu'à l'UGC et pas dans les cinémas d'art et d'essai de la ville, ou bien ils ont des acteurs ultra-connus en tête d'affiche, ou bien l'affiche, ou bien le titre, etc. Et puis en fait, on y va quand même. Et puis en fait, c'est merveilleux. Et puis en fait fait, du film probablement blockbuster-téléphoné-décevant, on donne sur un petit bijou, de ceux dont la réussite artistique reste avec nous et nous porte longtemps après la séance.
"The Perks Of Being A Wallflower", ou "Le monde de Charlie" en V.F. (pffff), fait partie de ceux-là. En apprenant qu'il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui entre au lycée, et qui, timide et sensible, se sent bien différent de ses camarades, avant de rencontrer des terminales super cools qui l'initient à la fête, la drogue et le sexe, bon, bon, bon, il y avait de quoi faire demi-tour : on voyait déjà les clichés, les messages bien-pensants et la morale puritaine remporter le tout, une sorte de "Glee" sans la musique. Stephen Chbosky, en adaptant son propre roman au grand écran (faites que chaque adaptation de livre soit réalisée par l'écrivain!), évite gracieusement tous ces pièges. Il dépeint un lycée effectivement cruel, empli de castes et d'intolérance, avec au milieu de ça, Logan Lerman jouant Charlie, jeune ado effectivement timide et sensible. Mais cette différence n'est jamais niaise : elle trouve au contraire ses racines dans un développement clair, profond et complexe du personnage. Et d'un coup, "Le monde de Charlie" passe de l'autre côté.
Charlie rencontre Patrick et Sam. Ezra Miller, redoutable dans "We Need To Talk About Kevin", habite ici un rôle diamétralement différent avec légèreté et maîtrise, d'un personnage extrêmement touchant dans un univers intolérant. Emma Watson, quant à elle, est lumineuse : on oublie tant son rôle précédent que je ne le citerai même pas... Elle est, sans nul doute, la seule des trois de "Harry Potter" qui, grâce à son talent, saura se forger une carrière intéressante. Si beaucoup de personnages secondaires verront leur rôle un peu sacrifié, les dialogues sont percutants, amusants, rarement à côté. Et l'épopée des trois protagonistes dépasse très rapidement le voyage initiatique de base : en réalité, le film brasse avec humanité et intelligence de nombreux thèmes, tout en faisant preuve d'une subtilité et d'une délicatesse rares. Les plus grandes horreurs seront murmurées avec tact, les plus petits plaisirs seront rugis avec passion, avant de tous se réunir dans un récit complexe, réaliste, et, ô surprise : surprenant.
Ajoutons à cela le charme suranné des années 80, une chaleur généreuse de l'image, cet aspect toujours un peu plus lisse, net et brillant du grain qu'ont les films à plus gros budget, une bande originale à se damner, de multiples savoureuses références culturelles, "The Rocky Horror Picture Show" en tête. Et puis encore cette sensibilité à fleur de peau qui traverse tout, les personnages, les images, la narration fébrile, cette subtilité pleine de goût dans la réalisation, les couleurs, la lumière. Et voilà : là où l'on s'attendait à un film d'ados faisant moins bien que les récentes figures de proue ayant renouvelé le genre ces dernières années (Gus Van Sant, "Skins"...), on se retrouve avec une œuvre puissante de poésie, d'intelligence, de beauté.
Inscription à :
Articles (Atom)